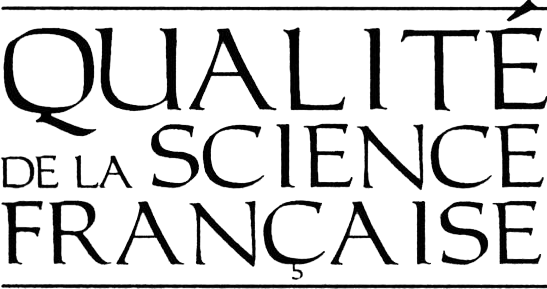Au lendemain du second tour de l’élection présidentielle, QSF a adressé au président réélu, Emmanuel Macron, le courrier suivant. Ce courrier s’inscrit dans la ligne du document publié par notre association en 2017 : Une université au service des savoirs et de la société. Diagnostic, perspectives et propositions pour une refondation de l’Espace de l’ESR[1]. Il s’inspire d’un nouveau document de synthèse actuellement en cours de rédaction.
Le 27 avril 2022
Monsieur le Président,
L’Association Qualité de la Science Française se réjouit que le vote de raison l’ait largement emporté le 24 avril et vous adresse ses vœux sincères et respectueux pour le prochain quinquennat.
Depuis sa fondation voici quarante ans, QSF s’efforce de porter un regard exigeant et impartial sur les évolutions de l’enseignement supérieur. En la matière, il nous faut l’avouer, le bilan du quinquennat écoulé nous apparaît insatisfaisant, et ce, même si l’on tient compte des nombreuses difficultés que la crise sanitaire a entraînées pour l’ensemble des établissements.
En 2017, la loi ORE a permis en théorie aux universités de choisir leurs étudiants : c’est une évolution positive, mais avec un dispositif qui reste à affiner. En 2020, la LPR a apporté un mieux dans le financement de la recherche et dans la rémunération des enseignants-chercheurs ; elle a toutefois manqué à apporter une solution satisfaisante aux problèmes liés à la ventilation des crédits de recherche (entre crédits récurrents et financements sur appels à projet), et a introduit dans les modalités de recrutement des enseignants-chercheurs des inégalités de traitement qui nous paraissent problématiques.
Sur le fond, le système universitaire français demeure largement sous-financé. La comparaison reste cruelle entre l’investissement public par étudiant et celui consenti pour les élèves des Grandes Écoles et des CPGE.
L’accueil et l’encadrement pédagogique des nouveaux étudiants dans les licences non sélectives ne peuvent satisfaire personne.
Nombre de ces étudiants, en particulier – mais non exclusivement – dans les filières SHS, ont été orientés par défaut et ne présentent pas les acquis intellectuels, culturels et méthodologiques indispensables pour les cursus concernés – à commencer par la maîtrise de la langue française. Nombre d’entre eux vivent dans des conditions économiques précaires qui les obligent à cumuler leurs études avec un emploi à temps partiel. L’accès de tous aux ressources documentaires tend à s’améliorer mais reste très perfectible.
Les aléas du système Parcoursup et les médiocres conditions d’études souvent offertes au niveau licence n’ont pu que favoriser le développement de l’enseignement supérieur privé, avec des formations à la qualité parfois incertaine, contrastant avec le lourd investissement des familles.
Les nouveaux dispositifs d’accès au master n’ont réglé qu’incomplètement le problème de l’accès à ce diplôme, de plus en plus considéré dans certains secteurs comme un brevet de fin d’études universitaires plutôt que comme un gage d’excellence et une préparation au doctorat.
Les enseignants-chercheurs sont, dans leur quasi-totalité, surchargés de tâches de gestion qui limitent d’autant le temps dont ils disposent pour leur recherche (laquelle, dans bien des domaines, n’a cependant rien à envier en qualité comme en quantité à la production des organismes de recherche).
Les calculs financiers des universités, toujours sous pression budgétaire, ont déterminé de nombreux gels de postes vacants : d’où, en comptant avec les besoins d’encadrement toujours croissants de certains départements, un recours toujours plus massif à des vacataires indignement sous-rémunérés.
Le système de recrutement des enseignants-chercheurs, moins unifié que jamais, accorde de moins en moins de poids aux qualifications et régulations nationales, et apparaît ainsi de nature à favoriser plus que jamais les ententes localistes. Celles-ci sont préjudiciables à l’attractivité et au dynamisme des carrières, avec ce que ce dynamisme implique de mobilité nationale et internationale, comme à la qualité scientifique des équipes.
Dans un certain nombre de disciplines, le nombre de postes MCF mis au concours apparaît minuscule au regard du vivier des jeunes docteurs de qualité. Faute de régulation nationale, ce faible nombre de postes met en péril la continuité de l’expertise et donc le potentiel de recherche et d’enseignement dans certains domaines du savoir.
Les carrières des personnels BIATSS n’ont pas fait l’objet d’un effort significatif, d’où une faible attractivité des emplois, très faible notamment pour ceux de catégorie C, attribués bien souvent à des personnes dévouées mais peu qualifiées.
La politique doctrinaire des regroupements ou fusions d’établissements a, selon les lieux, tantôt simplifié le paysage universitaire, tantôt accentué sa complexité et son peu de lisibilité. Elle a un peu partout contribué à distendre les relations collégiales, à accroître les tâches de gestion et à rendre plus complexes et aléatoires les relations entre les équipes pédagogiques, d’une part, et la gouvernance et les services centraux des établissements, d’autre part. Les inégalités de dotation entre établissements ont été creusées par l’attribution sélective de financements considérables sur la base d’évaluations discutables.
Dans un certain nombre de lieux, la précarité étudiante contribue, parmi divers facteurs, à une radicalisation des militantismes, d’où s’ensuivent des menaces récurrentes sur la liberté académique.
Nous nous en tenons ici aux points principaux. D’autres seraient à aborder. L’équilibre à respecter entre les diverses fonctions de l’université (lieu de recherches de pointe dans tous les domaines, conservatoire des savoirs, lieu d’études de régime libéral, en même temps qu’organe de formation professionnelle) est un grand sujet qui mérite d’être traité à part.
Au total, si certaines formations universitaires manifestent le dynamisme souhaitable et garantissent de bonnes conditions de travail à des étudiants dûment sélectionnés, l’encadrement et la cohérence des cursus reste, dans beaucoup d’autres, très en deçà de ce qu’on pourrait attendre d’une grande nation scientifique.
Au regard de ce tableau, les principales propositions et demandes de notre Association sont les suivantes :
- Financement des établissements. Outre le maintien des dotations ministérielles et des autres sources de financement, il serait nécessaire de faire accepter l’instauration de droits d’inscription progressifs, liés aux revenus du foyer parental, avec exemption pour les étudiants issus de classes défavorisées. On pourrait songer à quatre taux progressifs de droits d’inscription (500, 1000, 1500, 2000 €), éventuellement déductibles du revenu imposable des foyers fiscaux. Une telle mesure contribuerait à renflouer de manière importante le budget des universités, tout en renforçant la détermination des étudiants à bien employer leur temps d’études. Une participation progressive, en fonction des capacités contributives des foyers, est du reste plus juste que la gratuité pour tous.
Cette mesure serait doublée d’une restructuration, d’une revalorisation et d’une extension du système de bourses et des prêts étudiants, l’État et les collectivités devant par ailleurs investir massivement dans le logement étudiant.
La fiscalité des grandes entreprises devrait être aménagée de manière à encourager le mécénat en direction des universités publiques, sans contrepartie autre que symbolique.
- Entrée à l’université. Le système d’information et d’orientation post-bac doit être renforcé. Les prérequis disciplinaires correspondant à chaque formation universitaire demandent à être affinés. Tout en maintenant un système de cours magistraux, il convient de développer nettement les travaux dirigés en petits groupes (ateliers) au niveau L1-L2. Le recours au distanciel a montré son utilité dans des circonstances particulières mais doit être autant que possible économisé.
Pour l’entrée à l’université, un entretien individuel serait requis, suivi d’un bilan personnalisé et d’un nouvel entretien à l’issue du premier semestre de L1. Il appartiendrait bien entendu aux établissements et composantes concernés de faire le possible dans ce sens.
Il est par-dessus tout indispensable de créer en nombre des filières professionnelles courtes correspondant notamment aux métiers émergents. Les structures de remise à niveau en langues (y compris française), sciences et culture générale devraient être renforcées sur une base à étudier.
Mais en réalité, il conviendrait de procéder à un réexamen des structures de l’enseignement secondaire, visant à renforcer son efficacité dans chacune de ses branches. On ne saurait davantage se satisfaire de l’actuelle organisation du baccalauréat, qui se traduit par des taux de succès dépourvus de signification, mentions comprises.
- L’emploi à l’université. L’emploi précaire à l’université doit absolument être réduit par republication systématique des postes vacants et créations d’emplois selon les besoins dont la permanence est constatée. Des postes d’ingénieur d’études doivent être créés en nombre significatif, de manière à décharger les enseignants-chercheurs d’une partie des tâches de gestion. Les obligations de service des universitaires doivent être redéfinies de manière à prendre en compte la diversité de leurs tâches et à garantir leur temps disponible pour la recherche. Pour une meilleure gestion administrative et, de fait, un allègement pour les enseignants, les emplois et carrières BIATSS sont à revaloriser impérativement avec relèvement des compétences exigées. La revalorisation est également impérative pour les heures complémentaires, dont le nombre pour les enseignants titulaires devrait par ailleurs être sujet à plafonnement.
- Recrutement et carrières des enseignants-chercheurs. Les carrières doivent être rendues plus attractives, à la fois en termes de rémunération et par les conditions de travail offertes, sans recours à une dérégulation du recrutement, voie dans laquelle l’administration précédente s’est engagée. L’obtention d’une qualification nationale (par un CNU dont il conviendrait de revoir la composition et le mode d’élection) doit rester la règle pour l’accès aux fonctions de MCF. L’exigence de l’HDR doit être maintenue pour l’accès aux fonctions de professeur ; la qualification nationale, dont la suppression pour les MCF titulaires n’a jamais été justifiée, devrait être rétablie.
Les procédures de recrutement doivent être échelonnées dans le temps et présenter toutes les garanties d’impartialité, ce pour quoi diverses formules sont possibles. Un point clé : il ne devrait pas être possible de recruter sur un poste MCF un docteur de la même université n’ayant pas exercé ailleurs ; de même, les MCF d’un établissement ne devraient pas être autorisés, sauf situation personnelle clairement dérogatoire, à candidater sur un poste PR dans ce même établissement. En contrepartie, une aide et un encouragement financier à la mobilité devraient être mis en place.
Les modalités d’attribution des primes, récemment étendues de manière démagogique, devraient être revues et en toute hypothèse soustraites aux jeux d’influence locaux – une revalorisation indiciaire conséquente étant en toute hypothèse préférable à une extension de la politique indemnitaire.
- Évaluation et politiques d’établissement. Les établissements devraient être évalués prioritairement sur la qualité des formations offertes et sur celle de la production scientifique de leurs équipes. Les instances d’évaluation devraient être restructurées pour tenir compte de cette dualité.
Il devrait être mis fin, à tous les niveaux (L, M, D), à la politique du chiffre en matière d’inscriptions, qui subordonne l’attribution des moyens aux effectifs d’étudiants inscrits.
Les regroupements ou fusions d’établissements doivent cesser d’être encouragés quand ils ne répondent pas à un véritable projet d’intégration des formations et de développement de la recherche.
- Études doctorales et emploi des docteurs. Le renouvellement du potentiel national de recherche passe par une politique exigeante en matière de doctorat. L’entrée dans les études doctorales doit être préparée, puis conditionnée par une présentation orale à la commission compétente, comme c’est le cas pour l’attribution des contrats doctoraux. D’une manière générale, toute thèse devrait être financée, excepté pour les enseignants en exercice (PE, PLP) et autres fonctionnaires qui devraient bénéficier, à la demande des écoles doctorales, de dispositifs spécifiques pour pouvoir s’y consacrer.
Il devrait être enfin admis que la durée de préparation d’une thèse varie, comme sa forme et son volume, selon les secteurs disciplinaires. Des dispositifs de prolongation du financement de la thèse doivent être prévus pour les secteurs où cette préparation est la plus longue.
Si les comités de suivi ont leur utilité, et si les codirections et cotutelles sont le plus souvent fructueuses, la direction de la thèse ne saurait devenir collégiale. Tout problème déontologique lié aux relations entre directeur de thèse et doctorant doit en revanche pouvoir être examiné au sein de l’ED concernée et le cas échéant par les instances compétentes de l’établissement.
Les jeunes docteurs devraient pouvoir être largement employés dans l’organisation pédagogique des formations au niveau L1-L2 (travail en atelier). Le rétablissement d’un statut d’assistant non titulaire, supprimé en 1984, pourrait être envisagé.
Tout docteur en fonction dans l’Éducation nationale devrait conserver un rattachement à une équipe de recherche et bénéficier d’aménagements de service lui permettant de poursuivre ses travaux.
Un mécanisme devrait être institué pour pallier, sous le contrôle de l’instance nationale (CNU), les déficits criants de postes MCF (et ensuite PR) à pourvoir dans les disciplines ou sous-disciplines où ils s’observent.
- Financement et administration de la recherche. Il est d’abord indispensable d’augmenter et de pérenniser les crédits de la recherche publique ; mais aussi de procéder à une véritable refonte du système d’allocation des crédits, aujourd’hui contre-productif et source de nombreuses gabegies.
Cette refonte devrait mettre en avant les principes (a) de primauté du projet scientifique, (b) de souplesse dans la durée et le périmètre institutionnel des projets, (c) de simplicité du montage des dossiers et (d) de liberté dans l’utilisation des crédits dans le cadre de la loi.
À l’échelon local, les laboratoires doivent continuer à prendre en compte les dépenses individuelles des chercheurs et/ou à financer les projets internes pour des dépenses limitées à quelques milliers d’euros.
À l’échelon global (ANR), le système est actuellement pensé pour des financements en centaines de milliers d’euros dans un cadre quinquennal à la suite d’un concours lourd. Il convient toutefois de prévoir, grâce aux crédits récupérés auprès des opérateurs secondaires, une seconde procédure plus légère, pour des financements en dizaines de milliers d’euros d’opérations durant entre 1 et 5 ans. Pour la dévolution des financements à ces projets “moyens”, les critères devront être essentiellement l’intérêt scientifique, et autoriser des échéanciers et des périmètres institutionnels très variables, car privilégiant le principe de subsidiarité.
L’évaluation devrait partir des productions de recherche elles-me?mes, ce qui permettrait à terme de pallier certains dysfonctionnements, en diminuant le nombre de pseudo-travaux collectifs et en retrouvant une marge de financement pour les recherches individuelles sans coût supplémentaire pour la collectivité.
Outre le nécessaire refinancement de la recherche publique, il s’agit donc de changer entièrement de perspective, pour passer d’une culture de la procédure à une culture du résultat, orientée vers les besoins des projets scientifiques et des équipes qui les portent, et non vers les politiques des financeurs et des services.
- Gouvernance et autonomie des établissements. Le quinquennat écoulé et la LPR n’ont fait que confirmer le tournant managérial de la gouvernance des universités. Ce tournant est aussi contestable pour l’enseignement supérieur public qu’il l’a été à l’hôpital. Une université n’est pas une entreprise, et la mise en concurrence des établissements n’a pas de sens sinon sur le plan de l’attractivité scientifique et pédagogique. Le pilotage de la politique scientifique et pédagogique des établissements devrait être soigneusement distingué des autres tâches d’administration, et relever en propre d’un collège d’enseignants-chercheurs (sénat académique). La représentation des étudiants au sein des conseils centraux devrait être revue, de même que le rôle des personnalités extérieures, trop souvent choisies pour constituer une force d’appoint aux majorités présidentielles.
Le transfert par la loi LRU de la gestion de la masse salariale aux établissements n’a eu que des conséquences négatives. Seule une augmentation significative des budgets, en partie liée à une hausse des droits d’inscription (point 1), pourra permettre une gestion sereine et satisfaisante notamment sur le plan des ressources humaines. Plus généralement, comme nous l’écrivions en 2017, « sans ressources propres, sans un projet scientifique et pédagogique exigeant, sans une collégialité pleine (celle d’un sénat académique), l’autonomie des universités est un abus de langage et un marché de dupes »[2].
- Formation des maîtres. De la qualité de la formation initiale et continue des maîtres dépend celle du « niveau » des bacheliers arrivant à l’université. La question de ce niveau ne se pose pas en effet seulement en classe de terminale, mais dès l’école primaire. Or, pas plus que l’enseignement primaire et secondaire ne garantit aujourd’hui aux élèves la maîtrise de la langue française, il ne prépare au raisonnement scientifique, d’où un désintérêt massif des nouvelles générations pour la science. C’est là une bombe à retardement pour notre pays, qui se traduira beaucoup plus vite qu’on ne le croit par un déclassement technologique.
Bien que la formation des maîtres constitue en principe une des fonctions de l’université, celle-ci, dans la pratique, l’assure fort peu. Les cursus disciplinaires ne comportent pas de fléchage « enseignement », et les préparations aux concours du second degré – concours nationaux au principe desquels notre association est très attachée et dont la suppression même partielle lui paraîtrait, en l’état, catastrophique – prennent peu en compte les aspects didactiques et pédagogiques. Mis à part les licences de sciences de l’éducation (qui ne délivrent qu’une formation bien spécifique) et certaines licences pluridisciplinaires de préparation au professorat des écoles, la formation initiale des maîtres est donc réservée aux INSPÉ où elle reste assurée – à destination d’une partie seulement des nouveaux enseignants – sur des bases souvent insuffisantes et/ou doctrinaires, avec un « tronc commun » émietté et un cahier des charges écrasant pour le master MEEF. Quant à la formation continue des enseignants, elle relève largement de la fiction.
Après une réforme bâclée en 2013 et une autre superficielle en 2019, c’est une véritable remise à plat de la formation initiale et continue des maîtres qui s’impose si l’on veut que la France se dote enfin d’un système cohérent. Ce système, conçu dans un esprit libéral et non doctrinaire, devrait inclure un pré-recrutement dès le niveau licence, une formation approfondie des professeurs des écoles dans les matières de base, un enrichissement spécifique des enseignements disciplinaires, et une entrée réellement accompagnée et nouvellement progressive dans le métier (avec, à dater de la titularisation, les solides garanties statutaires faute desquelles ce métier ne peut s’exercer sereinement). La nature des relations entre les INSPÉ et les universités de tutelle ou avoisinantes devrait être profondément revue. Les résistances seront nombreuses, mais l’importance de l’enjeu se passe de démonstration. Une conférence nationale sur le sujet s’imposerait.
- Liberté académique. La liberté académique a fait l’objet de vives discussions au cours du quinquennat qui s’achève. Les deux années écoulées ont été marquées par quelques affaires retentissantes et par des polémiques confuses autour du thème de l’« islamo-gauchisme » en milieu universitaire.
À ce sujet, QSF a constamment souligné la nécessité de distinguer entre des recherches dont les orientations peuvent être discutées (essentiellement en SHS), et les actions de groupes militants visant à entraver la liberté d’expression ou la liberté d’enseignement. Les premières relèvent de l’évaluation par les pairs, les secondes exigent une action des présidences d’université dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il est de première importance qu’on cesse d’entretenir la confusion à ce sujet.
Il importe également de dissiper les confusions relatives à la liberté académique et à la liberté d’expression. Cette dernière est un droit de l’homme reconnu par les textes juridiques ; la liberté académique, quant à elle, est attribuée à ceux qui ont entamé la carrière universitaire, et vaut spécifiquement dans le cadre de leurs fonctions. Il en résulte notamment qu’un professeur qui s’exprime en dehors de sa spécialité peut invoquer sa liberté d’expression, mais non sa liberté académique, celle-ci étant par ailleurs indissociable d’une éthique académique liée à une « responsabilité devant le savoir » (P. Ricœur).
QSF plaide en faveur d’une reconnaissance de la liberté académique et invite les responsables (politiques et universitaires) à la respecter et à la faire respecter. Un texte de loi (ordinaire ou organique) sur le statut d’universitaire, remplaçant le très insatisfaisant décret de 1984, serait à cet égard précieux. Il est seulement requis du législateur qu’il soit réellement instruit du sujet et veille à ne pas dénaturer la liberté académique comme il a failli le faire dans le cadre de la loi LPR.
Telles sont, Monsieur le Président, nos principales remarques et propositions pour une action publique d’ampleur en faveur de l’ESR. Nous espérons pour le monde universitaire, réserve faite du contexte international, des années plus sereines que celles qu’il a traversées encore récemment. Prêts à prendre part à toute concertation à laquelle nous serions conviés, nous vous prions de recevoir, avec nos vœux renouvelés, l’assurance de notre respectueux dévouement.
Pour l’Association QSF,
Le président,
Denis Kambouchner
Ont contribué à la rédaction du document préparatoire au présent courrier : Olivier Beaud, Didier Blanc, Marc Cerisuelo, Joëlle Ducos, Thierry Gontier, Cécile Guérin-Bargues, Nicolas Kyriakidis, Loïc Merel, Élisabeth Pinto-Mathieu, Pierre Schapira, Jean-Gabriel Sorbara, Pascal Thomas, Paolo Tortonese, Sylvie Toscer-Angot.
[1] https://www.qsf.fr/wp-content/uploads/2019/04/Une-université-au-service-des-savoirs-et-de-la-société.pdf
[2] https://www.qsf.fr/wp-content/uploads/2019/04/Une-université-au-service-des-savoirs-et-de-la-société.pdf, p. 6.