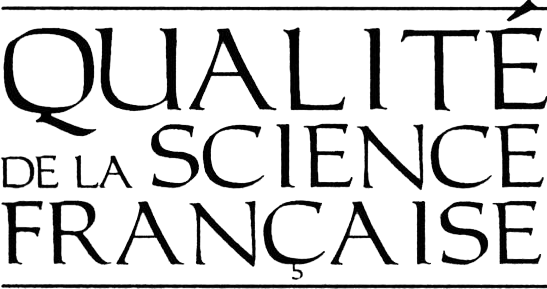Avec le printemps commence une période que tous redoutent, étudiants (futurs et actuels) et universitaires : c’est l’heure des candidatures à une formation de l’enseignement supérieur via des plates-formes uniques, Parcoursup pour la première année, Mon Master – la dernière-née du MESRI -pour l’entrée au master. Ces outils informatiques sont censés faciliter les inscriptions, aussi bien pour les candidats que pour l’administration des établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre d’une simplification administrative bénéfique.
Dans les deux cas, l’expérience des candidats, souvent médiatisée, et celle des enseignants-chercheurs qui en ont la charge, jamais évoquée, sont bien loin de l’idyllique. Complication des dépôts, avec des pièces multiples demandées, problèmes informatiques, lisibilité des offres de formation peu claire pour un néophyte, et parfois paiement de frais pour candidater à certains établissements qui apparaissent sans doute ainsi plus prestigieux, tels sont les griefs les plus fréquents pour ceux qui déposent leur candidature. Quant aux enseignants-chercheurs, qui doivent évaluer les candidatures alors qu’ils sont dans le même temps en charge des examens et de nombreuses autres tâches, leur enthousiasme est très relatif. Pour Parcoursup, si une procédure par algorithme permet un préclassement des très nombreux dossiers, elle est biaisée par des pratiques de notation de moins en moins homogènes, voire de surnotation, ce qui nuit à l’équité du traitement des candidatures. Les lettres de motivation sont de peu d’aide, soit par leur conformisme, soit – ce qui est nouveau – par le recours à Chat GPT, qui en renforce le formatage. D’où le sentiment très partagé d’aboutir à une liste peu satisfaisante et non à un classement juste et pertinent, qui donne toutes leurs chances pour une réussite des étudiants.
Pour Mon Master, la porte s’ouvrait grand, disait-on, pour répondre aux souhaits des nombreux étudiants de licence désirant poursuivre leurs études. 15 vœux dans un master recherche, 15 vœux dans un master professionnel, chacun devrait y trouver chaussure à son pied ! Sur le principe, on ne peut que s’étonner de cette présentation où les masters apparaissent comme des articles sur les étalages des supermarchés ou sur les plates-formes de ventes sur internet. Or le master ne constitue en principe ni une formation généraliste, ni une licence supérieure, mais une initiation à la recherche scientifique ou l’entrée dans une professionnalisation de haut niveau. Outre une formation préliminaire en licence et une solide culture disciplinaire, il requiert des compétences spécifiques, seules garantes de la réussite ; l’ouverture de cette plate-forme a démontré assez vite les conséquences de ce nouvel outil :
Pour les étudiantes et les étudiants : une prolifération inopérante des candidatures sur un outil unique, une orientation dans la jungle des formations qui s’avère complexe, et ce, alors que beaucoup comptaient poursuivre simplement un parcours cohérent conçu par leur université d’origine. À cela s’ajoute la production de nombreux projets de recherche et de lettres de motivation requis par chaque formation : dans ce cas, Chat GPT est devenu l’assistant indispensable, grand fournisseur de projets de recherche ubuesques et des bibliographies aussi saugrenues que fictives. Par ailleurs, les élèves de CPGE ont dû faire leurs vœux alors qu’ils passaient leurs concours, en l’absence de deuxième session. Il en résulte, pour les étudiants, une incertitude et une anxiété inévitablement accrues par les dysfonctionnements de Mon Master (bugs informatiques, informations contradictoires, alternance de fermeture et de réouverture). Le système par e-candidat géré par les universités était moins centralisé, mais assurément plus souple et plus accessible.
Les universitaires, quant à eux, ont découvert le mode d’emploi (paramétrage, accès aux dossiers) non en amont, mais au fil du processus en cours, les consignes étant dispensées parfois avec parcimonie ou tardivement ce qui a conduit à faire et défaire, telle Pénélope, les énormes tableaux Excel qui accompagnent inévitablement ce genre de procédure. D’où une interrogation permanente sur ce qui relevait de leur fonction et ce qui revenait à l’administration de leur université, comme la recevabilité des dossiers. La multiplicité des candidatures a eu pour corollaire une inflation des dossiers à examiner, alors que leur contenu montrait manifestement des vœux de circonstance, mais qui ne seraient sans doute pas suivis d’effet. Enfin les dysfonctionnements informatiques liés à la précipitation de l’installation de la plateforme par le ministère ont abouti à des dossiers beaucoup moins complets que les années précédentes. Le bilan est donc là aussi très mitigé : les universitaires, comme trop souvent, ont l’impression d’avoir des charges supplémentaires sans qu’elles soient d’un vrai apport pour leur métier ni pour les formations qu’ils assurent ; et surtout, au nom de la simplification administrative, de se transformer en spécialistes des tableaux Excel, devenus le seul mode de pensée administrative, hélas, même dans les universités.
L’Excellisation ne garantit pourtant pas l’excellence de la procédure de recrutement, encore moins un recrutement d’excellence.
Par ailleurs, cette foire au Master qui donne à l’étudiant l’illusion que tout est à portée de sa main risque d’accentuer des déséquilibres, tant au sein de la société que du système universitaire français. Certaines formations de province pourraient s’assécher en perdant les meilleurs étudiants qui, s’ils ont les moyens de se loger loin du domicile familial, pourraient être tentés par des universités de plus grandes villes. Certains étudiants, où qu’ils soient, ont besoin d’une place en Master dans leur université d’origine parce qu’ils ne peuvent pas financer un logement indépendant.
Il faut ajouter enfin que la centralisation de l’information sur les masters via Mon master contribue à lisser tous les systèmes de candidatures, tous les masters et tous les établissements, alors même que le master, à la différence de la licence, en tant que porte de la recherche scientifique, est la formation la plus révélatrice des spécificités et spécialités de chaque université. À la différence d’une licence, la formation du master est nécessairement multiple, diverse, et correspond pleinement à l’identité d’une université, voire aux spécificités socio-professionnelles d’une région. La nomenclature des masters unifiant leurs intitulés a été la première étape de cette standardisation. Mon master en est la deuxième, ce qui est d’autant plus paradoxal de la part d’un ministère qui, par ailleurs, déclare régulièrement la nécessité de l’autonomie des universités.
Il n’est évidemment pas question de revenir à des systèmes de candidature désuets, mais il ne s’agit pas non plus de considérer que le système de centralisation de candidature est la panacée. On voit bien les effets pernicieux qu’il peut provoquer, outre les candidatures inutiles qui surchargent le système : confusion des étudiants qui ne savent plus vraiment que choisir en s’imaginant qu’il faut absolument au moins 15 vœux, alignement de toutes les formations sur un schéma préconçu, absence de rôle décisionnaire des équipes pédagogiques sur leurs procédures de candidature, outre la surcharge de travail de secrétariat pour les universitaires sans réelle amélioration du recrutement pour leur master.
On ne peut que souhaiter une réflexion plus aboutie sur ce système, avec notamment un nombre plus raisonnable de vœux, une meilleure visibilité des éléments constitutifs de la base de données, une priorité accordée aux étudiants au sein de leur université, enfin une écoute des demandes de ceux qui forment les étudiants – et pour les universités, une plus grande autonomie dans les modalités des choix de leurs futurs étudiants.